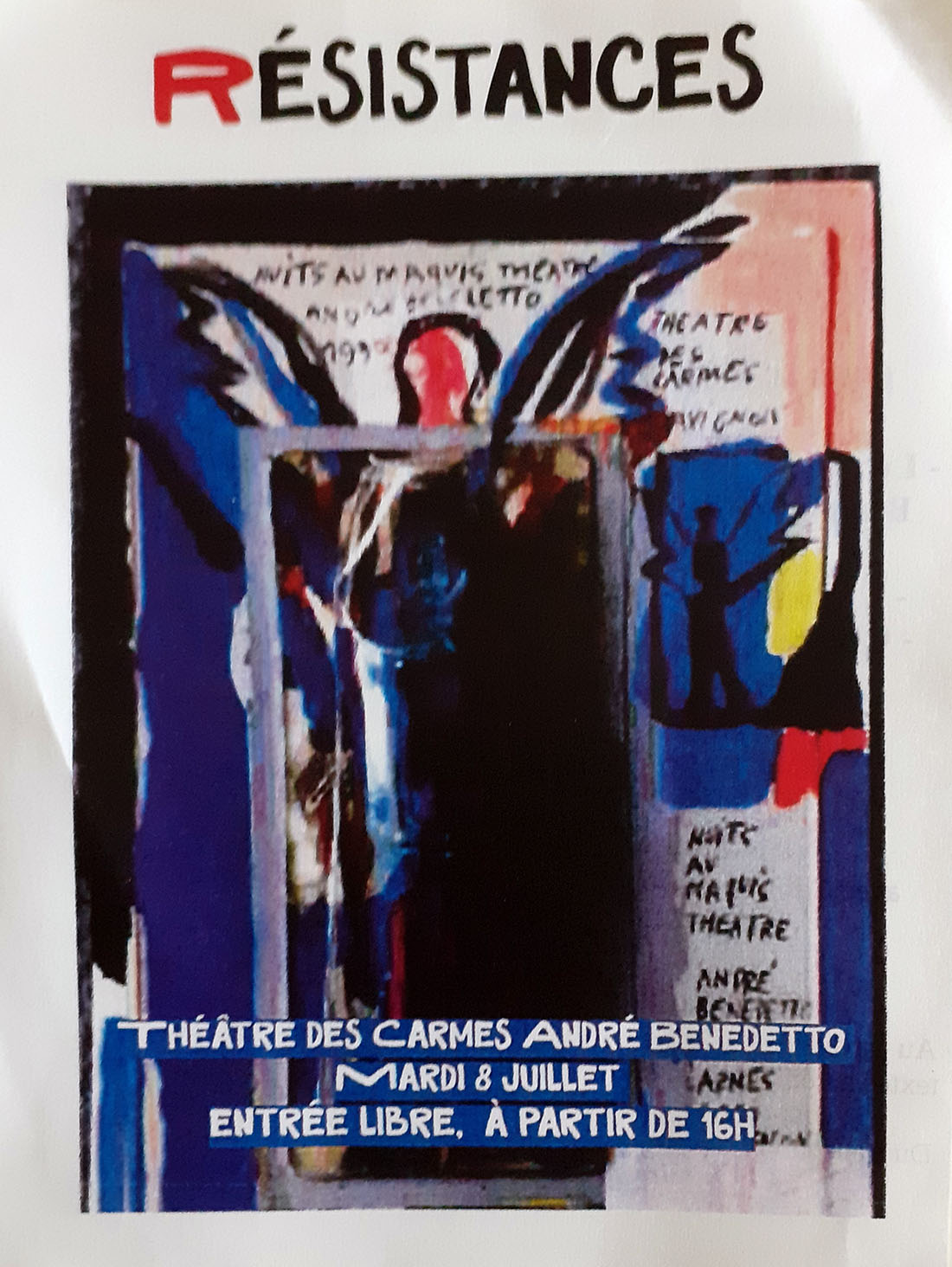
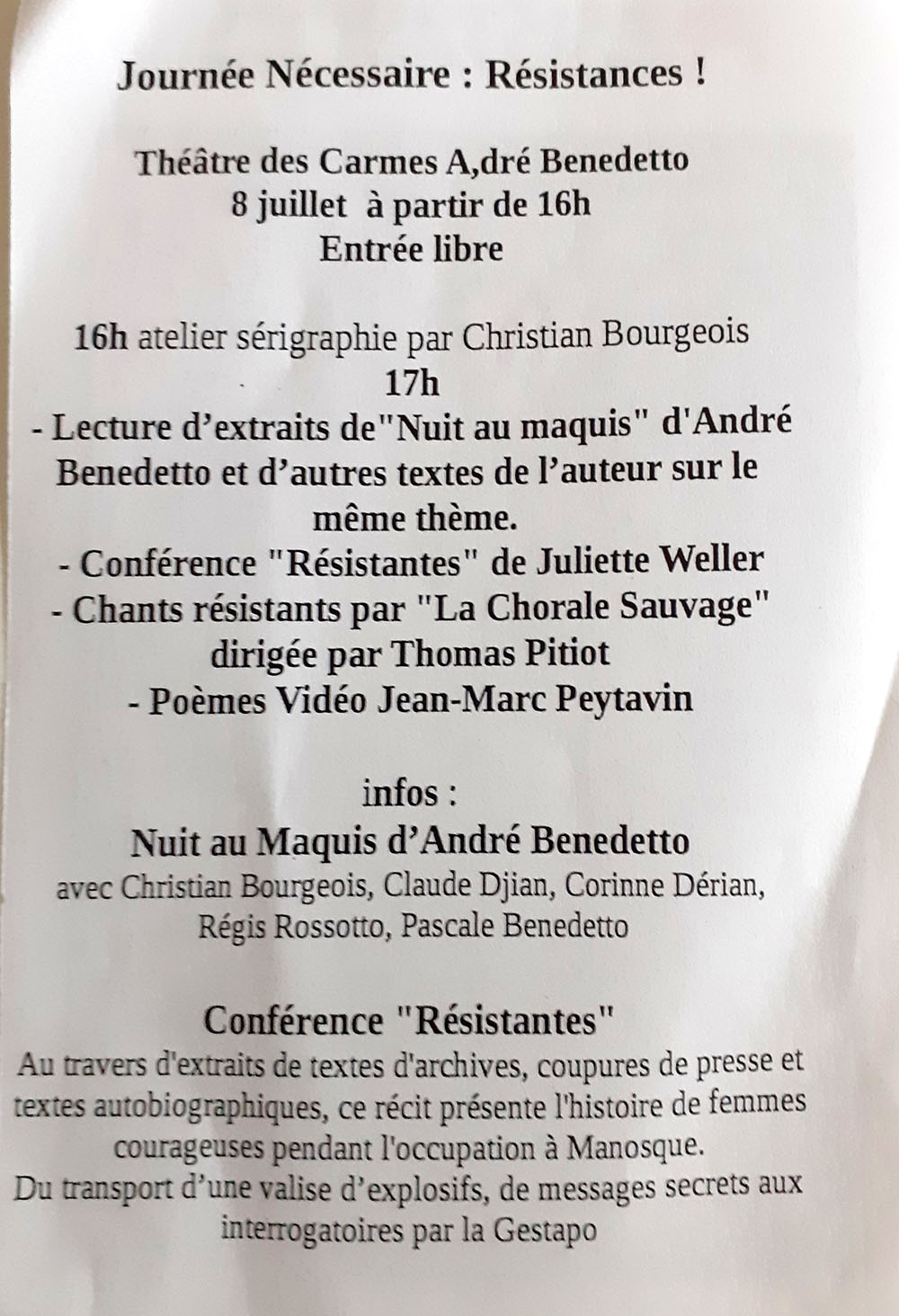


André Benedetto forum-débat
le 8 juillet 2025, « La journée nécessaire »
RESISTANCES / RESISTANTES

16h sérigraphie
17h extrait Nuit au Maquis
17h30 conférence lecture de Juliette Weller sur les Résistantes de Manosque
19h chants de Résistances
intermèdes clips vidéo





Clip audio-vidéo (20′)
Texte dit pour la première fois à la Fête de l’Humanité, le 13 septembre 1980,
avec le concours de la Cie Lubat .
Publié aux Editions Jacques Brémond : lien publication
reprise magnifique en 2012 de Nelly Pulicani
et en 2013 de Ph.Caubère
Des troubadours aux félibres, des camisards aux maquisards, le poète de Memento occitan déploie sa géographie élective, dépecée par les promoteurs : « L’Occitanie dans sa robe de sel et d’ocre / Et de terres abandonnées au plus offrant. » Le poète réveille la tradition du trobar clus et la mémoire des révoltes populaires occitanes pour mêler des noms rarement associés, tels Mistral et Jaurès ! Le souffle épique fait sonner le français et l’occitan avec la même ferveur. Si la langue pétrie d’Histoire de Benedetto renoue avec les grandes épopées populaires, ce n’est plus le héros singulier qui règne au cœur du chant mais la conscience collective à voix multiples. Renouveau d’un lyrisme révolutionnaire occitan à l’opposé du registre pittoresque et refusant tout enfermement régionaliste…
En 1966 André Benedetto avait enregistré lui-même sur le petit magnétophone de jean-Marie, la transcription du texte radiophonique d’Antonin Artaud de 1947 « Pour en finir avec le jugement de Dieu » . Puis la bande a été perdue. En 1980 on a refait un enregistrement dans un coin du théâtre des Carmes, en essayant de retrouver le même souffle. André avait également lu ce texte dans les années 2000 pour un vernissage de Bessompierre sur les marches de la bourse du travail à Arles.
Clip audio-vidéo (22′)
![]() AVIGNON OFF 24
AVIGNON OFF 24 ![]()
mardi 9 c’est 𝗹𝗮 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́𝗲 𝗻𝗲́𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 !
![]() à 14h 𝙊𝙪𝙫𝙧𝙞𝙚𝙧𝙨, 𝙥𝙖𝙮𝙨𝙖𝙣𝙨, 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙚𝙨 … une rencontre avec 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗯𝗿𝘂𝗻𝗲𝗮𝘂 Apicultrice, et 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗣𝗳𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴 Vigneron entremêlée de textes d’André Benedetto lus par Claude Djian, Christian Bourgeois et Regis Rossotto !
à 14h 𝙊𝙪𝙫𝙧𝙞𝙚𝙧𝙨, 𝙥𝙖𝙮𝙨𝙖𝙣𝙨, 𝙣𝙤𝙪𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙚𝙨 … une rencontre avec 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗹𝗲 𝗯𝗿𝘂𝗻𝗲𝗮𝘂 Apicultrice, et 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗣𝗳𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴 Vigneron entremêlée de textes d’André Benedetto lus par Claude Djian, Christian Bourgeois et Regis Rossotto !
![]() à 17h 𝙀𝙢𝙗𝙖𝙡𝙡𝙖𝙜𝙚
à 17h 𝙀𝙢𝙗𝙖𝙡𝙡𝙖𝙜𝙚
Contribution vidéo de JM Peytavin
Ultra rapide anniversaire des 60 ans du Théâtre des Carmes 28/10/2023
Christian Bourgeois – peintre, au Théâtre des Carmes le 27/10/2023

actrice dans les pièces d’André Benedetto:
1985 Tout Hugo d’un seul coup
1979 Pique-nique au moulin d’Ardus
1978 Ville à vif – L’Occitana Engabiada
1977 Saint-Féniant et Dame Paresse
– Parcours vénitien
1973 Les Tambours de Satan
1971 À bec et à griffes
1985 Peire Vidal, le loup polyglotte de Frédéric Vouland

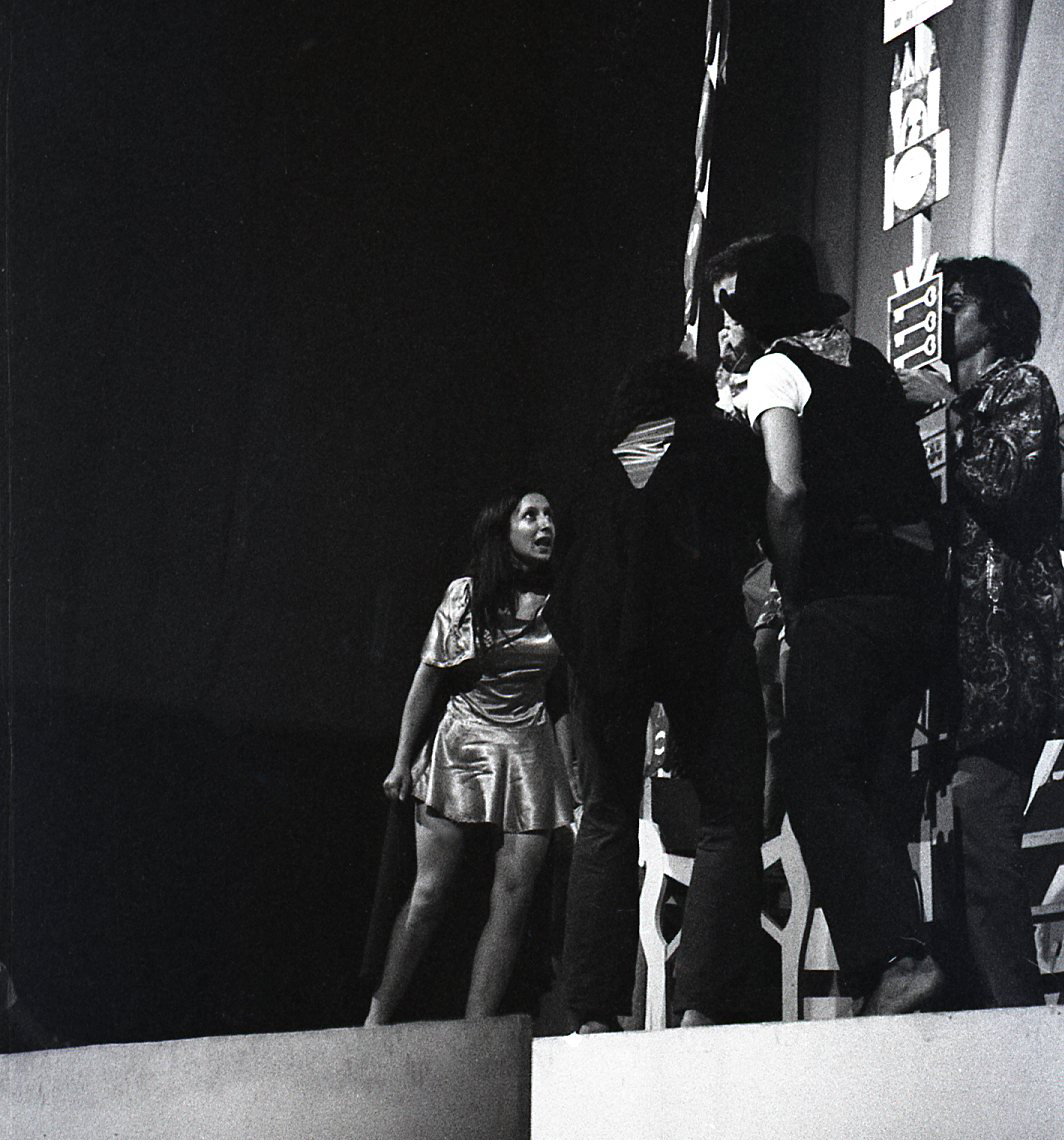
Avant programme
Inauguration de l’exposition-peinture de Christian Bourgeois « Les Menaçants », d’après sa série « les Ogres
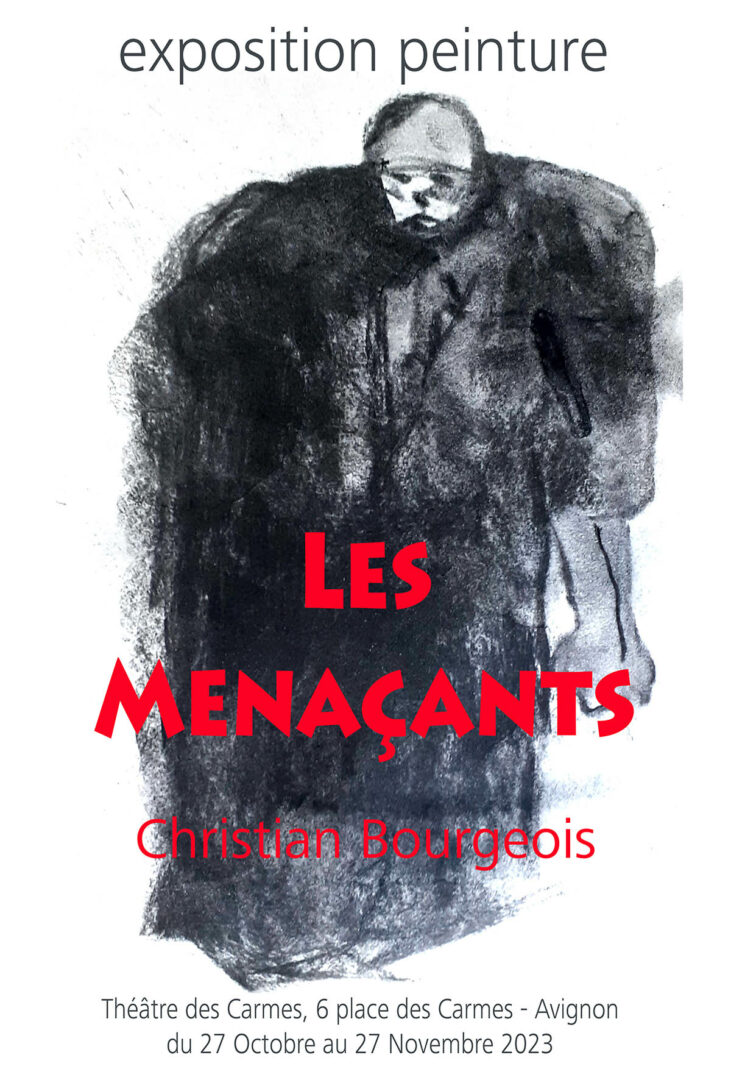
Christian Bourgeois, peintre, vit et travaille à Pouzilhac – Gard.
Compagnon de la première heure de la Nouvelle Compagnie d’Avignon, il a été chef décorateur télévision en côte d’Ivoire et au Sénégal, puis il a enseigné les arts plastiques à Paris. Il a accumulé une œuvre foisonnante, peu connue du public. L’exposition sera une bonne occasion de la révéler.
Le Théâtre des Carmes, depuis sa création, est attaché aux artistes-peintres contemporains, parmi lesquels on trouve Georges Beaumont, Louis Pons, Michel Trinquier, Ben Vautier, Ernest Pignon-Ernest, Pierre François, Cadène, Pierre Cayrol, Jacques Brianti, Bessompierre, etc
archive : article de Maïa BOUTEILLET publié dans Libération le 28 juillet 1999
…Vingt et une heure trente, place des Carmes. A l’aise dans ses sandales, la mèche gris argent, André Benedetto discute sur le trottoir, devant le théâtre qu’il a fondé en 1963 et où, depuis, été comme hiver, il joue et met en scène les textes qu’il a écrits.
Le Menaçant
Un texte en forme d’inachevé, «une tentative de représentation» où le poète livre ses inquiétudes face à la peste brune, ses débats intérieurs d’artiste contre le racisme et l’intolérance. Sortes de pensées à voix haute, sans doute nourries de la lecture des quotidiens et d’une bonne dose de méfiance à l’égard de la télé.
Posté devant le rideau rouge, «à la recherche d’un héros tragique qui pourrait incarner le Mal», il en profite pour donner un petit cours de dramaturgie. Une télécommande à la main pour faire la lumière comme bon lui chante, bonhomme, il explique qu’œdipe, héros tragique par excellence, était, au fond, «un type simple, bien que né à la cour, jusqu’au jour où un vieux lui a cherché des noises au carrefour». Et, poursuit-il, avec l’accent de la garrigue, «comme il a bien répondu à la question, un peu comme au jeu des Mille francs, voyez, il a gagné la reine. On l’imagine bien raconter ça dans un bistrot de toute façon, le théâtre, c’est d’abord une affaire de bistrot , attablé devant un pastis et des cacahuètes» » …
Exposition des œuvres de Christian Bourgeois
Lecture d’extraits de « Le Menaçant » d’André Benedetto
Dirigée par Régis Rossotto
Avec Claude Djian, Corinne Djian, Nolwenn Le Doth, Charlotte Michenaut, Thomas Billaudelle, Benoit Miaule, Régis Rossotto, Florent Terrier, Florian Martinet, Héléna Vautrin
Lecture d’extraits de « Jaurès la voix » d’André Benedetto
Par Jean-Claude Drouot
« Feu d’artifice » Benedetto
Avec notamment des extraits d’ « emballage » d’André Benedetto
Par Claude Djian et Marie Hurault
des extraits de « Lola Pélican » d’André Benedetto
Par Christine Matos
Vidéogrammes de Jean-Marc Peytavin.
Des surprises
Les 60 bougies et le gâteau à partager !
Entrée Libre
Réservation au 04 90 82 20 47
Projection de vidéogrammes dessinés par JM Peytavin sur des poèmes d’André Benedetto dits et enregistrés par l’auteur, plus un monologue en duo inattendu…
